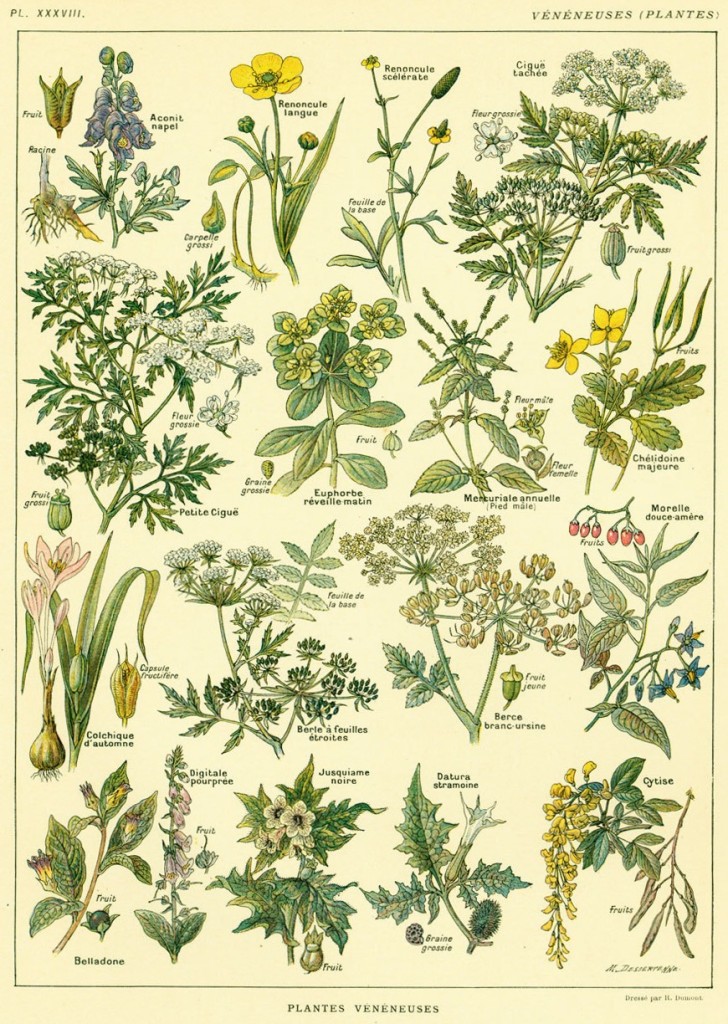« Ne cherchez plus mon cœur ; les bêtes l’ont mangé. »
Dionysos est, entre autres choses, le dieu de l’illusion. Dans Les Bacchantes d’Euripide, il donne l’impression à Agavé de se promener avec la tête d’un animal sauvage au bout d’une pique alors qu’il s’agit en fait de celle de Penthée, son fils, qu’elle vient avec ses consœurs Ménades de mettre en pièces – grosse ambiance. En grec, cet acte a pour nom σπαραγμός (sparagmos) ; ce sort a été subi à l’origine par Dionysos lui-même. Penthée est le roi de Thèbes, il représente l’ordre, la norme, et considère par conséquent « que les femmes, ce n’est rien du tout, de la crotte de bique1 », pour reprendre les mots colorés de Jean-Pierre Vernant, historien incomparable de la Grèce antique, lorsqu’il résume la pièce et ses enjeux ici. 400 ans avant Jésus-Christ, Les Bacchantes met en scène un déchaînement de violence féminine rarement égalé. Certes, les Ménades sont en pleine transe dionysiaque, mais cette férocité a suffisamment intrigué René Girard pour qu’il essaie de lui donner un sens. Dans La violence et le sacré, il la décrit, là aussi, comme une illusion qui vient se superposer à celle de la folie dionysiaque, une illusion qui substitue dans la fiction un groupe largement inoffensif dans la société grecque (les femmes) au groupe qui exerce la violence dans celle-ci (les hommes en âge d’être soldat), un déplacement destiné à conjurer plus radicalement les explosions de violences dont ces derniers sont les plus susceptibles.
Si ce brave René s’en sort avec ce tour de passe-passe, cet archétype de femme foncièrement sauvage, c’est-à-dire violente et hors de contrôle, a eu un succès certain dans les représentations. Le gouffre qu’il y a entre la violence fantasmée des femmes dans la fiction et son cortège millénaire de femmes fatales et les statistiques réelles a de quoi éberluer. Elle a des allures de miroir, celui d’une misogynie intense, protéiforme et millénaire, qu’elle provoquerait supposément, justifierait a posteriori en tout cas. Est-ce que c’est seulement ça, alors ? Une sorte de figure de style ? Qu’est-ce qu’on trouve, en fait, à cette intersection ténébreuse de féminité et de sauvagerie ?
C’est en tirant ce fil que je me suis retrouvée plongée (de manière plus ou moins fructueuse) dans des livres avec des titres comme Histoire de la misogynie2 ou Pourquoi les hommes ont peur des femmes3, et à méditer longuement (de manière plus ou moins fructueuse aussi) sur ces histoires de femmes et de sauvagerie. À défaut d’élaborer une théorie très ordonnée4, voici ce que j’ai glané en suivant quatre pistes : sentier escarpé ou autoroute, impasse ou chemin de traverse, on y croise en tout cas des bêtes à cornes ou à crocs, des moments de transes et de libations, et, évidemment, dépiautages et autres démembrements.




 Il est plus que temps d’enterrer l’été. Nous sommes sacrément en retard, oui, mais il faut dire que les feux du soleil ont été longs à s’éteindre, dorant activement jusqu’aux premières semaines d’octobre les feuilles et les esprits alanguis qui déjà, rêvaient de son retour… Pour notre part, si nous avons abandonné avec chagrin les longues soirées d’août, les éclaboussures ensoleillées du matin et du soir, et le contentement des moissons, comme vous le savez déjà, nous n’aimons guère l’été.
Il est plus que temps d’enterrer l’été. Nous sommes sacrément en retard, oui, mais il faut dire que les feux du soleil ont été longs à s’éteindre, dorant activement jusqu’aux premières semaines d’octobre les feuilles et les esprits alanguis qui déjà, rêvaient de son retour… Pour notre part, si nous avons abandonné avec chagrin les longues soirées d’août, les éclaboussures ensoleillées du matin et du soir, et le contentement des moissons, comme vous le savez déjà, nous n’aimons guère l’été.