
Quand je m’attelle à cette troisième édition de La Mort Propagande (en mars 2024, gloups), j’attends avec impatience la sortie de nouveaux albums de Darkthrone, d’Einstürzende Neubauten et même – retour miraculeux que plus personne n’attendait – de Mütiilation. Un alignement des planètes assez exceptionnel pour que même une adepte de la vie dans le passé dans mon genre tique et en vienne à se poser l’épineuse question de Dale Cooper à la fin de Twin Peaks : « What year is this ? » On est en quelle année, là, exactement ?
Au même moment, je tombe je ne sais plus trop comment sur une série d’articles (dont je recommande vivement la lecture et même l’épluchage approfondi aux anglophones) qui se propose d’« appliquer » Rétromania de Simon Reynolds au cas du metal. Une idée qui me trottait dans la tête depuis des années, et que je suis très contente de pouvoir lire sans avoir dû m’y coller, vue l’ampleur de la tâche. Comme son nom l’indique, le pavé roboratif et stimulant qu’est Rétromania parle de « l’addiction de la pop à son propre passé ». Sa lecture il y a quelques années m’avait beaucoup marquée : impossible en effet de ne pas remarquer que d’une part, les personnes qui m’entourent de la génération de Reynolds semblent bien plus préoccupées par le manque flagrant d’innovation de la pop culture que moi, et que de l’autre, ma génération, justement, paraît coincée dans un espace-temps indéfinissable, sorte de passé-présent perpétuel qui tient plus de l’expérience du hamster dans sa roue que du temps suspendu de l’âge d’or – c’est le moins que l’on puisse dire. Un article du philosophe britannique Mark Fisher sur E-flux résume les choses ainsi : « À la fois politiquement et esthétiquement, on dirait que nous ne pouvons plus espérer que plus de la même chose, pour l’éternité ».
Par goût et par inclination naturelle, je suis du genre nostalgique. J’ai l’impression d’accomplir un exploit quand je lis quelque chose qui a été écrit après les années 1940. Je fais une fixette sur le tournant des années 1980-90 – celles de ma naissance/petite enfance. J’ai l’impression de n’avoir rien vu émerger de nouveau de mon vivant, aucun changement de paradigme aussi radical que le punk, le surréalisme, la techno, que sais-je ; que le XXe siècle peine à mourir, que le XXIe n’a jamais commencé, ou peut-être qu’il est mort-né, sorte d’avorton bizarre dans lequel nous sommes tous piégés. Mes tendances anxieuses font sans doute un peu mentir mon indifférence revendiquée pour le futur, dans lequel je suis incapable de me projeter ; reste que je peine vraiment à m’y intéresser. Il doit quand même y avoir là-dedans quelque chose qui dépasse mes préférences et lubies personnelles, qui est de l’ordre de l’air du temps. Sinon, pourquoi on ne proposerait aux trentenaires que des groupes sur le retour en têtes d’affiche de festivals ? Revival grunge, revival emo, revival « rock un peu insipide des années 2000 », pardon, « indie sleaze », sortes de line-ups « Âge tendre et tête de bois » pour millenials ? Des films qui sont des remakes, des spin-offs, des franchises essorées jusqu’à la nausée ? Est-ce que ce n’est pas un peu insultant, à force ? Depuis que je suis adolescente, j’attends que quelque chose se passe. Peut-être que c’est là que ça a cafouillé.
Lors d’une discussion avec une amie plus âgée, je me retrouve à admettre : « Peut-être que ma génération était tellement occupée à attendre que quelque chose se passe qu’elle a oublié que c’était à elle de le faire ». On nous a tellement saoulé avec les grandes heures des années 1960-70-80-90, on nous a tellement répété que notre futur s’annonçait pour le moins incertain, en tout cas beaucoup moins bien, qu’on y a peut-être collectivement cru. Au lieu de dire à ceux qui nous bassinaient avec le bon vieux temps d’aller se faire voir avec leurs disques ringards, on s’est dit : « Peut-être bien qu’ils ont raison ». On cherche leur reconnaissance, on mime leurs chansons et leurs tenues ; même sur le plan politique, je ne me souviens pas d’une seule manif faite durant mon adolescence qui n’ait pas été écrasée sous les souvenirs d’un mai 68 fantasmé, sous le poids du : « Est-ce qu’on fait ça bien comme il faut ? » De fait, l’air du temps était extrêmement différent. Même en prenant en compte les effets d’optique, difficile de ne pas remarquer que sur à peu près tous les plans, l’atmosphère est franchement plus étouffante, anxiogène, voire atroce, qu’à l’époque. Le manque que nous ressentons est bel et bien là, il est sans doute la raison pour laquelle nous nous créons des quantités aussi astronomiques de doudous culturels qui nous rappellent de bons vieux temps que souvent, nous n’avons même pas connus : peut-être que ça vaut la peine de se demander de quoi il en retourne, exactement.
Le metal ne fait pas exception. Je ne compte plus le nombre d’interviews faites avec des vétérans des débuts des scènes black/death où je n’ai pas réussi à résister à l’inévitable : « Alors, c’était comment à l’époque ? C’était si bien que ça ? » Et oui, c’était si bien que ça. Les anecdotes d’anciens combattants s’accumulent. J’essaie de ne pas m’en tenir aux soupirs rêveurs ; j’essaie de comprendre ce qu’il s’est passé. Une conférence (qui date de dix ans déjà, ce qui en dit sans doute long) de Mark Fisher encore, découverte parmi les réflexions sur le metal et le rétro de Hate Meditations justement, m’a donné beaucoup de grain à moudre et une bonne poignée d’illuminations. À des fins de propagande, je l’ai traduite ici – pas d’excuses pour ne pas vous y pencher, donc. Mark Fisher, qui à mon grand désarroi est mort suicidé il y a quelques années, mérite d’être lu, écouté, entendu ; vu sa perspicacité quasi visionnaire à l’époque, je suis certaine qu’il nous aurait ouvert des pistes utiles et passionnantes aujourd’hui. Il nous reste ses livres : c’est déjà beaucoup.
Dans « La lente annulation du futur », Fisher nous parle de pathologies temporelles, du fait que le temps semble avoir changé de nature, s’écouler bizarrement, voire plus du tout. D’une certaine façon, le temps est devenu « tout David Lynch »1, plein de boucles et d’à-coups, de simultanéités troublantes, de distorsions vertigineuses. Au tournant des années 1980-90, Twin Peaks était vraiment de son temps, avec sa nostalgie un peu satirique pour les années 1950 assumée et lisible comme telle. Dans la saison 3 (sortie vingt-cinq ans plus tard, en 2017) en revanche, la façon dont le temps s’écoule est particulièrement incompréhensible, secouée de soubresauts, de glitches, de locked grooves. « What year is this ? » est la dernière phrase qui y est dite. Si j’y pense autant depuis que je l’ai entendue, c’est sans doute pour une bonne raison.
∴
Je me remets à cet article des mois plus tard, en décembre 2024, après une journée un peu étrange où j’ai entamé Ghost of my Life – de Mark Fisher toujours – puis interviewé Saturnalia Temple avant un concert pour parler de leur dernier album, le primitif (primordial ?) Paradigm Call. Sans vraiment d’intention délibérée de ma part, la conversation a dévié d’elle-même sur le sujet du chapitre que j’étais en train de lire : la nostalgie, la créativité débordante des années 1989-1993, la tendance actuelle à rester coincé dans le passé. Dans sa version actuelle, Saturnalia Temple compte dans ses rangs la tête pensante du groupe, Tommie Eriksson, qui a grandi pendant la période la plus fertile et mouvementée du metal – les années 1980 – puis a traversé les années 1990 dans toutes sortes de groupes, notamment Therion, et les frères Pelle et Gottfrid Åhman. Trentenaires dont la carrière a commencé en grande pompe en plein revival heavy metal avec In Solitude, ils se sont peu à peu émancipé de Mercyful Fate, Iron Maiden et consorts avec Sister, album syncrétique, inoubliable et hanté. Après le split du groupe, ils ont continué leurs explorations dans d’autres projets, dont j’avais un peu parlé ici. Le bien-nommé No Future (tiens donc) ressort des morceaux de passé suffisamment oubliés pour sembler ultra contemporains, ou atemporel comme de la folk2 ; PÅGÅ est composite, haptique, à la fois familier et pas vraiment de ce monde, très, très David Lynch. Bref, le casting était idéal pour aborder le cœur de la question.
Alors quoi ? Alors il y a une forme de satisfaction à se rendre compte que le vécu empirique de musiciens colle d’aussi près aux esquisses dessinées par un philosophe aux oreilles aiguisées, qu’il y a bien des lignes de forces qui se dessinent, même dans des scènes différentes (post-punk/musique électronique pour l’un, metal pour les autres), que de façons différentes, nous sommes nombreux à nous ressentir aux prises avec les mêmes choses. Après tout, on pourrait s’en ficher que la musique reflète d’autres époques que celle dans laquelle nous vivons ; elle ne nous doit rien. Mais cette impression de trop (de passé, de déjà-vu) correspond à une impression de pas assez (de vie, de sincérité) : c’est peut-être dans cet interstice-là que tout peut se jouer. Certains artistes sont déjà au turbin. Les utopies et les dystopies du passé nous semblent, sans doute à raison, plus fertiles que les nôtres, celles que nous ne sommes plus capables d’inventer, celles qui sonnent toujours bizarrement creux, déjà dépassées : faute d’autre chose, c’est peut-être en effet de cela que nous devrions essayer de faire quelque chose.
∴
Je sais, je sais, cette introduction était déjà presque un article à elle toute seule. Vous avez tenu jusqu’ici, alors respirez un grand coup : ci-dessous, quatre albums de black metal (pour compenser le fait qu’il n’y en avait aucun ici) abondamment écoutés début 2024, plus un bonus plus récent car pourquoi s’arrêter en si bon chemin. Tous se trouvent comme par hasard négocier avec le passé, le présent et le futur.
3. « I MADE THESE WINGS OF THE ASHES
OF THE OLD SOIL »



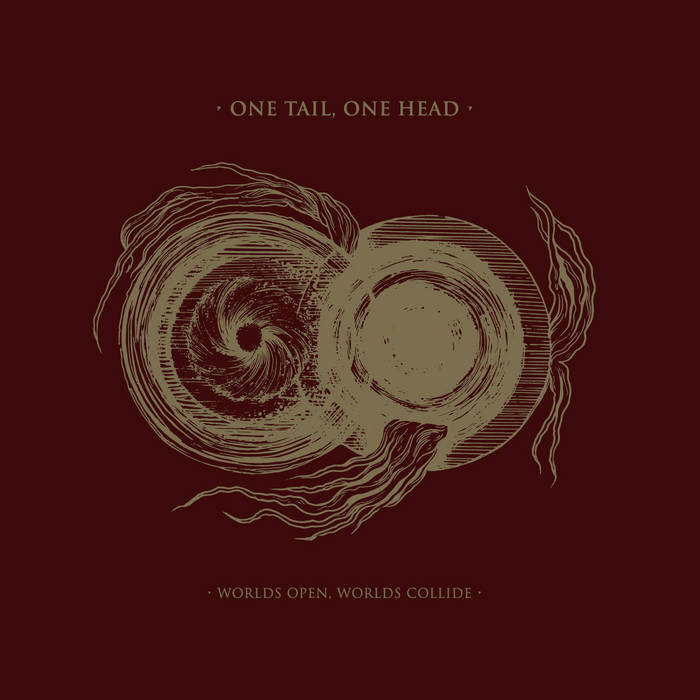
Neo Inferno 262 – Pleonectic
« Cette échelle d’excitations désespérées […] »
Dans le genre « retour miraculeux que personne n’attendait », Neo Inferno 262 se pose là. Le groupe, à l’époque plus ou moins mystérieux who’s who de la scène parisienne, avait sorti son seul album Hacking the Holy Code en 2008, à une époque post-crash (raté) de l’an 2000 où l’influence de Mysticum se montrait particulièrement fertile pour le black français3. Quinze ans après cet opus satanico-futuriste ambitieux, bien de son temps mais unique en son genre, et malgré un line-up drastiquement réduit, le projet a sorti Pleonectic, tout aussi ambitieux que son prédécesseur, et tout aussi en prise avec son époque, utilisation de l’intelligence artificielle et problématiques ultra-contemporaines incluses.
C’est peut-être en l’écoutant et en y réfléchissant pour préparer mon interview avec la tête pensante du projet, A.K. (de Decline of the I, Merrimack, etc.), que ce post a commencé. L’album aborde de front toutes les problématiques temporelles auxquelles on est confrontés : le passé qui s’étire à l’infini – les riffs de black, intemporels et chargés –, le présent immédiatement obsolète – A.K. fait remarquer que les parties electro de Hacking the Holy Code sont les plus datées ; celles de Pleonectic sont variées, palpitantes, mutantes –, le futur qui s’est fait la malle (« Peut-être que sur Pleonectic, je suis plus inspiré par ce qui se passe réellement, là où le premier album était plus dans une fantasmagorie SF vraiment littéraire »). Les neuf morceaux qui le composent sont pleins à craquer de trouvailles, d’atmosphères différentes et de possibilités, nouées ensemble par le fil rouge du black metal (la guitare d’A.K. et la voix d’L. Helheim, présentes sur tous les morceaux) ; ils sont tellement denses – tant conceptuellement que sensoriellement – que l’expérience en est presque cinématographique.
Il faut dire que le casting est, lui aussi, sacrément riche4 : à défaut d’y retrouver la patte de chacun, l’effet est kaléidoscopique, du jazz un peu black lodge (de Twin Peaks, pas le groupe) de « SEXES » au tempos qui accélèrent de « Death Is Overrated » en passant par l’ambient bien dark de « Pleonectic ». Cette abondance va bien à un album dont le titre signifie « avoir plus », dont l’objet est l’avenir : c’est en effet à ça que ressemble l’horizon sur à peu près tous les plans ; l’indigestion alors qu’on n’a même plus faim. L’indigestion justement, A.K. l’évite grâce à une architecture méticuleuse et une sorte de lyrisme bien particulier, un art du tri et de l’émotion qui fait qu’on parvient à respirer malgré tout. Pour combien de temps encore ? On le saura bien assez vite.
Mysticum – On the Streams of Inferno
« Pour la première fois, une psychopathologie bienveillante nous faisait signe. »
Comme je fais tout à l’envers, je ne me suis mise que relativement récemment à Mysticum. Le groupe bénéficie pourtant d’un pedigree ultra trve (On the Streams of Inferno était censé sortir sur Deathlike Silence, le label d’Euronymous) et a créé un sous-genre à la seule force du poignet – ou du concours de circonstances qui les a amenés à tomber sur une boîte à rythme alors que leur batteur venait de quitter le groupe, disons. Le sous-genre en question, c’est évidemment l’industrial black metal, qui n’a pas nécessairement grand-chose à voir avec la musique industrielle – à part « Industries of Inferno » et quelques photos neubauteniennes pleines de charme – mais qui incorpore toutes sortes de sonorités électroniques, et se retrouve donc à la convergence des lames de fonds les plus culturellement corrosives – metal extrême, techno, satanisme, drogues de synthèse – de cette fin de vingtième siècle.
Tout décharné qu’il soit, le black metal d’On the Streams of Inferno a un côté more is more toujours aussi percutant trente ans plus tard. La voix criarde, la boîte à rythme qui tabasse, les nappes de synthé jamais très loin d’être kitsch, les samples horrifiques, les riffs hâves et hostiles : tout est toujours à deux doigts de basculer dans la série Z et reste pourtant parfaitement glacial, menaçant, hiératique. Par la suite, le groupe peinera à se hisser à nouveau aussi haut sur la ligne de crête, mais c’est en live que la magie opère. Vus au festival Samhain à Maastricht, ils sont mon meilleur concert de 2023, et plus largement, l’un de mes meilleurs concerts de black. Set-up épuré jusqu’au minimalisme, jeu de lumière en noir et blanc, trio au diapason, ultra-soudé façon muraille (pas tout à fait) humaine : le résultat est tendu, sardonique, très agressif, et lors de quelques moments de grâce (« Kingdom Comes »), fait véritablement froid dans le dos5.
Galvanisé par les apports sonores et psychoactifs/métaphysiques de la techno (« Black Magic Mushrooms », sorti après l’album mais ajouté en bonus sur la réédition récente), avec Mysticum, l’étrange millénarisme des débuts du black metal6 prend des proportions cosmiques, plus que fin-de-siècle, fin-de-millénaire, façon errance dans les ruines et quête d’un nouvel univers. Celui-ci sera matérialisé vingt an plus tard par leur Planet Satan7, et, plus globalement, par un troisième millénaire qui s’annonce hélas – ces vingt-cinq premières années ne laissent guère de doute – ni le leur, ni le nôtre…
Dødheimsgard – Kronet til Konge
« Le monde commençait à fleurir en plaies. »
Puisque j’en suis à ressortir les classiques norvégiens, il faut bien que je parle de Dødheimsgard, qui d’ailleurs a sorti un disque remarquable et remarqué, « nostalgique sans vraiment être nostalgique »8, Black Medium Current, à peu près au même moment que le nouveau Neo Inferno 262, et qui est notoirement passé par le black metal industriel. Ce n’est pas de celui-ci que j’ai envie de parler, cela dit : c’est de Kronet til Konge, leur premier album, sorti en 1995, en pleine explosion/décapilotade du black metal de la deuxième vague, pour la simple et bonne raison que c’est l’un de mes albums préférés de cette période.
Il a le côté pur et dépouillé typique du « True Norwegian Black Metal » de l’époque, la pochette en noir et blanc, les photos en corpsepaint dans les bois, les paroles en norvégien, le satanisme revendiqué, la production rudimentaire-mais-géniale, liquide-minérale-atmosphérique ; il a même Fenriz de Darkthrone en (relatif) contre-emploi à la basse. Pourtant, il ne ressemble à aucun autre9. La voix d’Aldrahn est écorchée, bilieuse, possédée par moment, mais loin des hurlements de sorcière qu’on connaît – la tristesse n’y est jamais très loin de la rage et vice-versa – ; la basse, peu saturée, presque gothique, n’est pas seulement le soubassement de la guitare, mais offre des contre-points plus mélodiques, souvent mélancoliques. Des passages comme le début de « Mournfull, Yet and Forever » (ah, ce titre ! ces fautes d’orthographe miraculeuses !), le cœur de « Kuldeblest Over Evig Isøde » ou celui de « When Heavens End » sont déchirants, tout simplement beaux, brillants et ténébreux comme seul le black metal peut l’être.
C’est là que Kronet til Konge s’illustre : dans cette tristesse, cette mélancolie toujours poignante et jamais sentimentale qu’on ne trouve guère que dans les vieux Burzum et dans Transilvanian Hunger. Mais là où la nostalgie de Burzum est abstraite, nébuleuse, aspiration à un passé lointain et fantasmé, celle de Transilvanian Hunger et Kronet til Konge est tangible, habitée ; elle est nostalgie d’un passé qui vient de glisser des mains, d’un black metal à peine touché qu’il est déjà perdu, de l’adolescence, peut-être. Car comme pour Marguerite Duras et pour moi, très vite dans la vie du black metal, il a été trop tard : dès 1993, d’une certaine façon, tout était déjà plié. C’est ça que Kronet til Konge retranscrit de manière éclatante, à la fois hommage à ce qui le précède immédiatement et au manque, à ce qu’on a raté, aux aspirations démesurées auxquelles on peine à renoncer.
One Tail, One Head – Worlds Open, Worlds Collide
« L’énorme énergie vingtième siècle, suffisante pour projeter la planète sur une nouvelle orbite autour d’une étoile plus heureuse,
était en train d’être dépensée pour maintenir cette stase immense. »
J’ai vu One Tail, One Head en concert il y a une dizaine d’années maintenant, à un festival. Je me souviens d’un set tardif10, de beaucoup de rouge, et c’est à peu près tout. J’y suis revenue bien plus tard, par hasard, en pleine phase où j’écoutais Kronet til Konge matin, midi et soir : malgré les pas loin de vingt-cinq ans qui les séparent, Worlds Open, Worlds Collide (qui hélas a récemment disparu d’internet me semble-t-il ; je vous invite donc à casser votre tirelire, utiliser vos méthodes modérément légales favorites, ou me demander les mp3) m’a immédiatement semblé être le même genre de créature. Dans la forme d’abord, avec son chant hargneux et habité pas très loin de celui d’Aldrahn, et puis surtout sa basse atypique, claire, à laquelle on doit bien des sommets de l’album. Et puis dans le fond, avec un esprit orthodoxe et respectueux des pionniers du style d’un côté et une patte très singulière de l’autre, plus encore que sur les sorties ildjarno-darkthroniennes qui l’ont précédé. Les deux ont des paroles qui méritent d’être lues, aussi – c’est assez rare pour être souligné.
La scène de Trondheim, très active à l’époque, nous a encore offert de valeureuses sorties récemment11, mais aucune ne m’a fait oublier le crépusculaire Worlds Open, Worlds Collide. Peut-être que si je ne m’en lasse pas, c’est que comme tous les albums sus-mentionnés, il fait cohabiter les contraires, il ne devrait pas fonctionner, et pourtant il le fait – avec panache. On y retrouve ce que le groupe a d’incandescent, de fuligineux en live, quelque chose d’abrasif et de rock’n’roll à l’occasion, mais aussi la froideur enveloppante du bon vieux black metal norvégien. L’haleine bestiale et la forêt enneigée à la fois, disons. Du marasme façon soupe primordiale ou de l’incendie apocalyptique – on ne s’ennuie pas pendant ces quarante-cinq minutes, les visions se succèdent, imprévisibles et variées –, One Tail, One Head émerge avec une sorte de grâce, d’élégance qui lui est complètement propre (ah, « Stellar Storms » !).
Le groupe a annoncé sa fin à peu près en même temps que la sortie de ce premier album, après une dizaine d’années d’existence, tout de même. Ce qui est certes regrettable, mais qui va bien à ce serpent qui se mord la queue. Début et fin, ouverture et écroulement, Worlds Open, Worlds Collide abolit les oppositions en une synthèse flamboyante (quel sens du titre au passage – « Summon Surreal Surrender », peut-on imaginer mieux pour tirer sa révérence ?). De quoi créer une brèche temporaire dans cet aplatissement bizarre de la temporalité, à défaut de nous en sortir pour de bon.
Bonus rapide car le drame lorsqu’on met un an à écrire un article, c’est que de nouveaux albums continuent de sortir entre temps : Zéro Absolu – La Saignée
«[…] la complexe arithmétique humaine de ces blessures […] »
Je vais essayer de faire bref, et donc ne pas m’appesantir sur les querelles intestines qui ont fait muter Glaciation (qui avait sorti 1994 il y a une dizaine d’années) en Zéro Absolu. Toujours est-il qu’avec La Saignée, Valnoir et ses comparses continuent de régler leurs comptes avec leur passé, leur présent, et surtout ceux du black metal, comme on le comprend dès la pochette qui reprend une photo du providentiel (!) incendie du magasin de disques Neseblod (ex-Helvete, et donc peut-être ce qui se rapproche le plus d’un lieu de culte pour le black metal) à Oslo. Ce tiraillement entre attachement sincère au vieux (au « vrai ») black metal et volonté d’aller de l’avant est très présent dans le versant graphique du travail de Valnoir, dont on ne compte plus les pochettes aux concepts visuellement ou conceptuellement novateurs, mais dont une partie importante du travail imprimé est dédiée à l’archivage – à la commémoration peut-être – de feu le black des années 199012.
Musicalement, en revanche, qu’est-ce que ça donne ? C’est bien moins amer qu’on pourrait se l’imaginer au vu des titres et du propos, volontiers mélodique, avec en guise de sucre des moments de nostalgie lumineuse très Alcest (apparemment des membres du groupe ont été impliqué, ceci expliquant cela), et des nappes de clavier méditatives sur « Le temps détruit tout ». Mélancolique, triste mais sans pitié, l’album tape sur tout le monde, les vendus, les tièdes, soi-même ; il éructe les déceptions, les compromissions, les idéaux qui s’effritent, l’eau qu’on met dans son vin – le temps qui passe, en somme. Au milieu de tout ça émerge la voix de Meyhna’ch de Mütiilation qui résume, implacable : « Le black metal, c’est la mort, et ça doit rester la mort ». On n’a toujours rien inventé de mieux pour éviter le futur, et les vicissitudes qui vont avec…
Bon… Une publication par an, c’est bien aussi, on va dire. Que chaque personne arrivée jusqu’ici soit remerciée pour son courage et sa détermination. Le titre (« J’ai fait ces ailes des cendres / de l’ancienne terre ») vient de « Firebird » de One Tail, One Head. Les citations qui émaillent l’article viennent quant à elles de Crash de J. G. Ballard. Je les ai traduites moi-même, même si j’aime vraiment beaucoup l’« échelle de sensations apocalyptiques »13 de l’édition française. Il fait partie de ces livres que je relis périodiquement et qui me glacent/brûlent/sidèrent à chaque fois. C’est tordu et absolument logique, c’est superbement écrit, ça a un pouvoir de hantise très élevé, même pour quelqu’un qui se contrefiche des voitures et/ou n’a même pas le permis (je suis bien placée pour le savoir). Même s’il date d’il y a un moment désormais (1971), il semble à la fois bizarrement futuriste et très contemporain, comme c’était déjà le cas dans le film de David Cronenberg en 1996. Autant dire qu’il tombait à pic !
La bannière-danse macabre de La Mort Propagande a été dessinée par la valeureuse et infiniment douée Fève D. Qu’elle en soit vivement remerciée, tout comme de sa précieuse relecture !
1 Encore quelqu’un dont le regard singulier et étrangement visionnaire va terriblement manquer. Je n’avais pas prévu de faire un article-mausolée, je voulais faire un article sur le futur. Bon. Toujours est-il que je vous redirige vers le spécialiste ès temps-tout-David-Lynch Pacôme Thiellement pour en savoir plus sur la question.
2 Peut-être que The Birthday Party ou Scratch Acid c’est, dans le fond, une sorte de folk, comme le black norvégien ; une musique tellement viscérale qu’elle n’est attachée à aucune époque, à toutes à la fois. En tout cas, No Future a (enfin !) sorti il y a peu son premier album, disponible ici, et… c’est tout. Ce choix de l’objet (très DIY, très soigné) plutôt que du streaming est rare, anachronique, et leur va comme un gant. La musique est à l’avenant, belle, sans âge, ténébreuse et lumineuse à la fois. « There’s a future for No Future » nous disait Erik Danielsson, qui ne résiste jamais à un bon mot, il y a quelques années ; il y a un futur pour l’absence de futur. S’il faut une conclusion à cet article, elle est là, juste au début – évidemment.
3 Au hasard, chez Black Lodge, évidemment, et puis le Diapsiquir des débuts. Je l’entends même dans la décriée et fort synthétique boîte à rythme de Black Millenium (Grimly Reborn).
4 L. Helheim de Moonreich, Déhà d’on ne compte plus tous les groupes, MKM d’Antaeus et Aosoth, Saint Vincent et NRK de Blacklodge, Bornyhake de Borgne, BST d’Order of Apollyon, Heimoth de Seth, Krys d’Ophe, Berzerk de Malhkebre, S. d’Ars Veneficium, L. de Mourning Dawn, Arnhwald de Deathcode Society, S. d’Owl cave, Dehn Sora de Throane, et puis on peut ajouter Valnoir de Metastasis aux visuels. Le protocole qu’à suivi A.K. pour la création de l’album est détaillé dans l’interview en question.
5 Leur performance au Roadburn a été enregistrée et on peut l’acheter et/ou l’écouter ici.
6 Qu’on pense seulement au fameux mot d’ordre de Darkthrone : « We are a blaze in the northern sky / The next thousand years are ours » [« Nous sommes un flamboiement dans le ciel du nord / Les mille prochaines années sont à nous »]…
7 Là encore, une filiation imprévue avec Mütiilation et ses Sorrow Galaxies se dessine.
8 Selon Yusaf « Vicotnik » Parvez, grand architecte et seul membre permanent du groupe himself, lors d’une longue discussion que j’ai eu la chance d’avoir avec lui il y a quelques mois après plusieurs occasions manquées, où nous avons parlé de l’étrange et anagrammatique Doedsmaghird et de Dødheimsgard, évidemment.
9 On m’a récemment fait remarquer un peu narquoisement qu’il y a bel et bien un album qui lui ressemble un peu : For All Tid de Dimmu Borgir. Malgré mes cris d’orfraie, il faut bien reconnaître qu’au niveau des riffs, il y a en effet quelque chose ; il y a aussi Vicotnik et Aldrahn en guest au chant, alors…
10 Après investigation, c’était bien le cas ; j’ai dû aussi sortir après une vingtaine de minutes pour ne rien rater du set d’In Solitude qui avait lieu dans une autre salle. Grand bien m’en a pris puisqu’il s’agissait en fait de leur dernier : c’est d’ailleurs au même endroit, dix ans plus tard, qu’a eu lieu l’interview de Saturnalia Temple mentionnée dans mon introduction à rallonge – ouf, la boucle est bouclée !
11 Whoredom Rife a sorti un album l’année dernière, tout comme Vemod, dont j’adore Venter på stormene, mais dont The Deepening m’a laissée sur ma faim.
12 Je pense au récent Arma Christi, au plus ancien Krieghallen, à Analogue Black Terror, et surtout à No Contact : dans le fond, on y retrouve tout ce qui faisait les zines des années 1990 (les interviews, les chroniques, et partout, la patte de l’auteur/éditeur, griffes acérées incluses), mais dans la forme et le choix des artistes visuels présentés, on a plutôt affaire à un livre d’art, superbe et plein de trouvailles graphiques. Morgan de Marduk façon Salomé tatouée de Gustave Moreau, par exemple.
13 Pour « This ladder of desperate excitements ».

